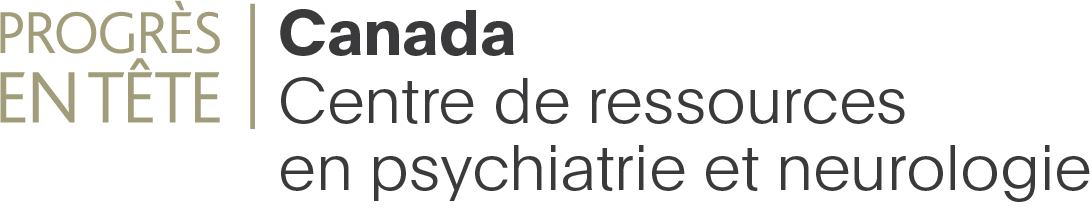La dépression réfractaire au traitement (DRT) est décrite comme l’absence de rémission des symptômes après l’essai d’au moins un antidépresseur (AD) administré à une dose thérapeutique pendant une période appropriée ou encore, après l’essai d’au moins deux AD successifs, également à une dose thérapeutique pendant une période appropriée1,2. Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de définition consensuelle de la DRT ni de cadre de référence universel à ce sujet, ce qui a des implications cliniques – surtout si l’on cherche à préciser la prévalence de la DRT et à éclairer les décisions politiques1. Lors d’un webinaire éducatif intitulé Improving the Lives of Patients with Depression, offert par le Neuroscience Education Institute (NEI), le Dr Roger McIntyre, professeur titulaire, départements de Psychiatrie et de Pharmacologie, University of Toronto, a présenté les derniers développements concernant le diagnostic et la prise en charge de la DRT et fait le point sur la terminologie employée.
Prévalence et fardeau de la DRT
Le trouble dépressif majeur (TDM) est une maladie incapacitante qui abrège la vie; en effet, au Canada, chez les personnes atteintes de dépression comparativement aux personnes non déprimées, l’espérance de vie ajustée en fonction de la santé est nettement plus faible et le taux de mortalité prématurée, nettement plus élevé3. La dépression réfractaire au traitement (DRT) contribue de manière disproportionnée au fardeau économique global du TDM; en effet, près de la moitié du fardeau économique annuel lié au traitement médicamenteux du TDM est imputable à la DRT4. Cela n’est guère surprenant, puisque parmi les patients aux prises avec un TDM, un patient sur trois ne parvient pas à la rémission après l’essai d’un premier antidépresseur (AD); chez les deux tiers des patients, il faudra essayer quatre AD différents avant d’obtenir une rémission des symptômes5. Fait important, à chaque nouvel essai, la probabilité d’une rémission symptomatique diminue et, le cas échéant, l’obtention de la rémission est plus longue5. De plus, aux stades plus avancés du parcours thérapeutique, l’association entre rémission des symptômes et rétablissement fonctionnel n’est pas linéaire, et le retour à l’état fonctionnel initial est moins probable – même en cas de rémission symptomatique6. Le Dr McIntyre explique que cet écart entre rémission des symptômes et rétablissement fonctionnel pourrait en partie être dû à l’évolution du trouble dépressif avec le temps. Plus particulièrement, les symptômes persistants d’un dysfonctionnement cognitif, de l’anhédonie, du manque de motivation et de la fatigue peuvent compliquer l’amélioration fonctionnelle.
Les deux tiers des patients recevant un premier AD pour un TDM ne parviennent pas à une rémission symptomatique5
Problèmes liés aux définitions actuelles de la DRT
La classification de la DRT varie selon le nombre d’essais d’AD ayant échoué. Beaucoup d’instances de réglementation définissent la DRT comme l’échec d’au moins deux AD successifs, mais certains groupes de recherche utilisent comme seuil l’échec d’un seul AD1. Selon le Dr McIntyre, les définitions et les critères définitoires actuels de la DRT sont incomplets et font abstraction de nombreux éléments importants du tableau. Par exemple, l’échec n’est pas différencié selon la classe d’AD essayée et le recours à la psychothérapie, à des traitements de neurostimulation, à différentes stratégies de traitement d’appoint ou d’association; la sévérité de la maladie au départ, les difficultés psychosociales, la durée des épisodes dépressifs, ou diverses caractéristiques telles que l’anxiété, l’anhédonie, les caractéristiques mixtes, ou l’adversité durant l’enfance ne sont pas prises en compte; la notion «d’échec» n’est pas clairement définie et ne tient pas compte de la présence d’une réponse partielle ou de symptômes résiduels; également absents du tableau sont les résultats rapportés par les patients, lesquels sont généralement davantage axés sur la qualité de vie et le fonctionnement que sur les symptômes dépressifs1,2,7. Fait à noter, les définitions actuelles de la DRT ne reflètent pas précisément le tableau clinique de la «dépression difficile à traiter» (DDT), notion qui gagne du terrain. De fait, dans la version 2023 de ses lignes directrices cliniques pour la prise en charge du TDM chez les adultes, le CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) fait la distinction entre DRT et DDT, donnant à cette dernière une définition plus large (tenant compte des traitements psychologiques, des traitements de neuromodulation, etc.) et exempte de la connotation négative associée à la DRT2 (en ce sens que le patient ne porte pas le blâme de sa non-réponse au traitement).
Par rapport à la DRT, la DDT est une notion émergente fondée sur une approche plus descriptive et plus collaborative1,2,7
Schémas thérapeutiques et lignes directrices pour la DRT
En dépit de la prévalence élevée de la DRT et du lourd fardeau qu’elle impose, des données probantes semblent indiquer que de nombreux patients continuent de recevoir un traitement sous-optimal en dépit d’une réponse inadéquate pendant des années. Une étude en conditions réelles réunissant près de 500 000 patients atteints d’un TDM a révélé que la majorité de ces patients (91%) prenaient un AD en monothérapie et que seuls 9% d’entre eux recevaient un agent d’appoint. Le taux d’abandon était ≈ 80 %, indice possible de l’inefficacité des AD en monothérapie8. En outre, les agents d’appoint avaient généralement été prescrits en 3e intention, plus d’un an après l’AD initial8. Cela contraste vivement avec les recommandations actuelles, y compris les lignes directrices 2023 du CANMAT pour la prise en charge du TDM, selon lesquelles il faut recourir plus tôt à un traitement d’appoint dans l’éventualité d’une réponse inadéquate au premier ou au deuxième AD (administré à une dose adéquate pendant une durée appropriée)2 et éviter de multiples cycles de traitement par un AD.
Il y a des lacunes dans les recommandations quant à l’instauration du traitement d’appoint pour la DRT
Le Dr McIntyre souligne également l’importance d’interrompre un traitement inefficace de manière appropriée, au moment opportun. Il cite le scénario clinique courant où l’on augmente graduellement la dose d’AD prescrite pour une DRT et, au final, la dose maximale recommandée dans le libellé de la monographie est largement dépassée. Certes, lorsque la réponse à un AD initial est limitée, on recommande dans un premier temps d’optimiser le traitement jusqu’à l’obtention d’une dose thérapeutique2; cependant, une fois cette dernière atteinte, la réponse plafonne, et de nouvelles augmentations de la dose seront de moins en moins rentables du point de vue de l’efficacité, mais accroîtront le risque d’effets indésirables2.
Suivant les lignes directrices, lorsque la réponse demeure inadéquate une fois la dose optimisée, il faut envisager:
- de changer d’AD si l’on observe des effets indésirables incommodants ou une amélioration de la réponse < 20% par rapport aux valeurs initiales, en vertu d’une échelle validée d’évaluation des symptômes; ou
- d’ajouter un agent d’appoint si l’AD initial est bien toléré et induit une réponse partielle (amélioration ≥ 20%)2.
Comparativement au changement d’AD, cette seconde stratégie est plus solidement étayée quant à son efficacité et à la rapidité d’obtention d’une rémission2
Les stratégies d’appoint peuvent cibler des symptômes résiduels précis observés après l’essai d’un premier AD2
Plusieurs autres stratégies médicamenteuses ou non médicamenteuses peuvent être envisagées dans le traitement de la DRT et de la DDT. Il existe un intérêt grandissant, et de plus en plus de données probantes au sujet des modulateurs des récepteurs glutamatergiques, lesquels sont recommandés par le CANMAT en 2e ou en 3e intention, selon les agents et la voie d’administration2. Plusieurs autres molécules pour le traitement de la DRT sont à l’étude, mais l’on ne dispose pas actuellement de preuves suffisantes pour en recommander l’utilisation dans la pratique courante1. En présence d’une DRT dont la réponse à un ou à plusieurs traitements médicamenteux est inadéquate, il faut également envisager des stratégies non médicamenteuses1,2. Notamment, il a été démontré que les traitements de neurostimulation sont très efficaces dans la DRT, et l’on dispose de preuves étayant les avantages d’un traitement psychologique d’appoint1,2.
Plusieurs stratégies médicamenteuses et non médicamenteuses étayées par des données probantes sont recommandées pour la DRT1,2
Bien qu’elle participe de manière disproportionnée au fardeau du TDM, la DRT demeure mal définie, et la population hétérogène de patients touchés par la DRT tend à être sous-représentée dans les études cliniques1. Le Dr McIntyre a fait valoir l’importance de poursuivre le développement de traitements novateurs – médicaments, traitements psychologiques et neuromodulation afin d’améliorer les résultats dans cette population de patients dont les besoins importants ne sont pas comblés.
Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.