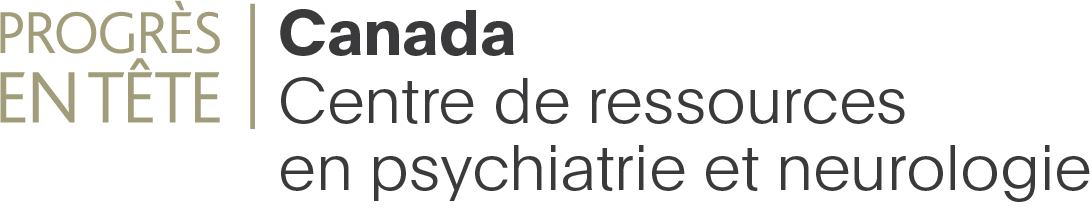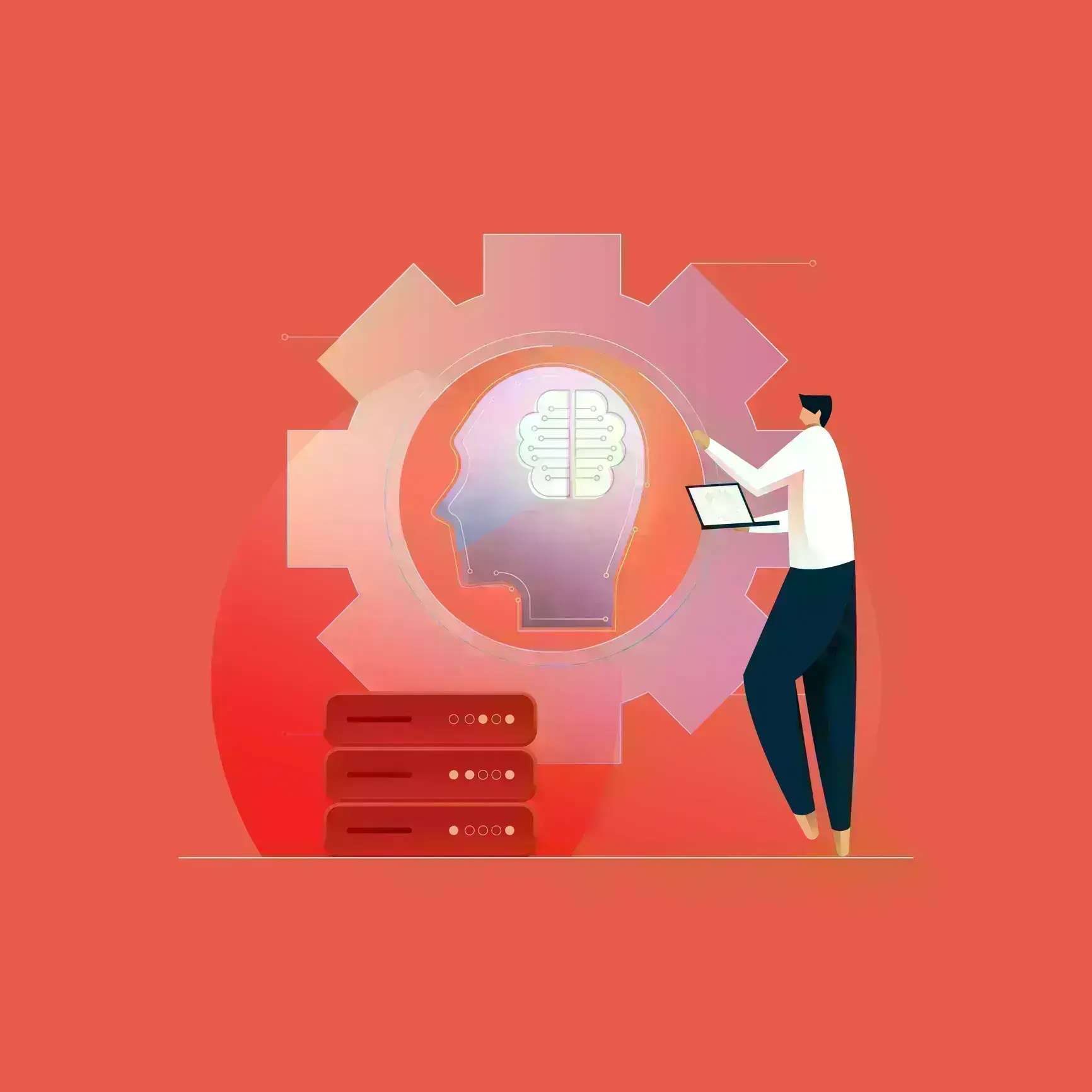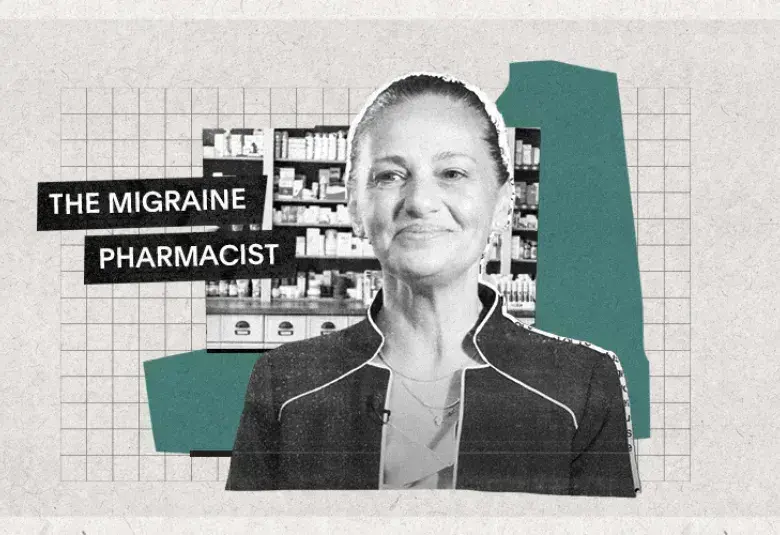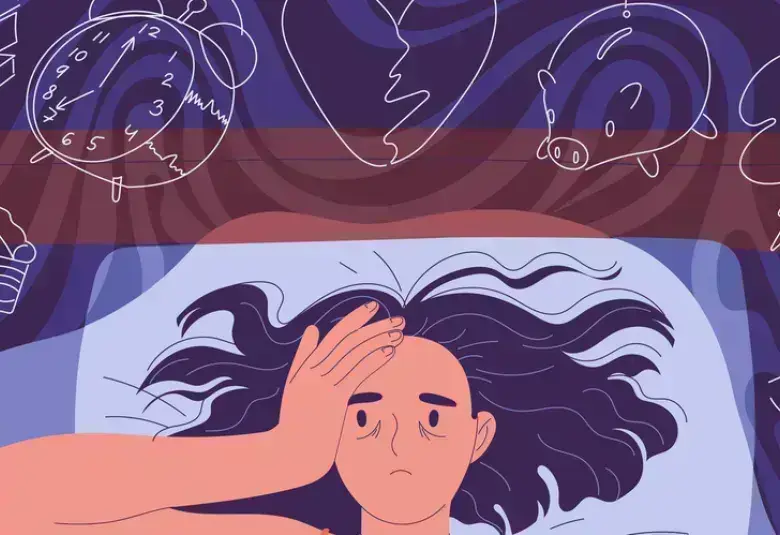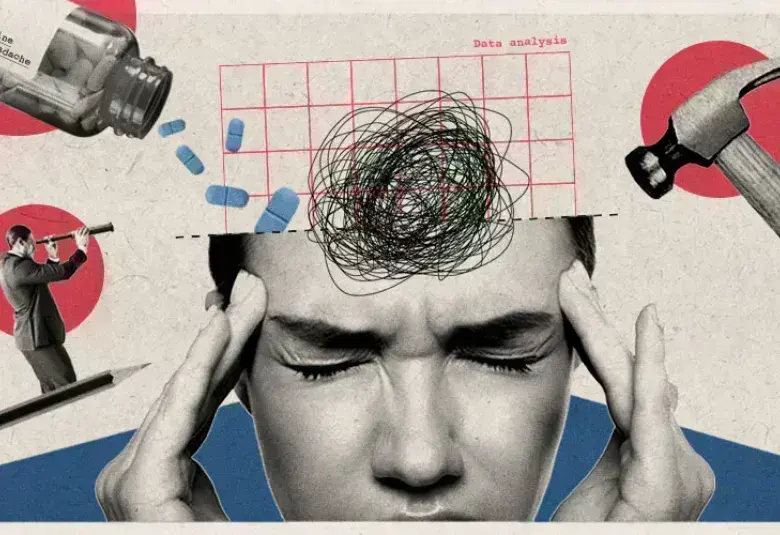L’utilisation de biomarqueurs prédictifs qui guideraient le choix du traitement antidépresseur pourrait contribuer étroitement à l’optimisation des résultats dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM). Le réseau CAN-BIND (Canadian Biomarker Integration Network in Depression) est à l’avant-garde de la recherche sur la découverte et la validation de biomarqueurs cliniques et moléculaires ainsi que de biomarqueurs en neuro-imagerie et en électro-encéphalographie (ÉEG) à l’aide d’approches et de plateformes innovantes en recherche. Des chercheurs de CAN-BIND ont fait une présentation sur le sujet durant l’une des séances de la conférence annuelle 2024 de l’Association des psychiatres du Canada (APC) à Montréal.
Dans les lignes directrices sur le traitement du TDM, il est maintenant recommandé de commencer par un antidépresseur et d’optimiser la dose, puis d’ajouter un agent d’appoint sans délai en cas de réponse inadéquate1. Cette approche thérapeutique permet d’obtenir une réponse clinique chez environ les deux tiers des patients atteints d’un TDM2, mais il y a encore pas mal de place à l’amélioration pour les patients vivant avec la dépression.
Même après l’utilisation précoce d’un traitement d’appoint, le tiers des patients atteints d’un TDM n’obtiennent pas de réponse
L’utilisation de biomarqueurs prédictifs pourrait aider à repérer les patients plus susceptibles de répondre – ou de ne pas répondre – à certaines stratégies de traitement. CAN-BIND a mené des recherches sur divers types de prédicteurs de la réponse au traitement, notamment des prédicteurs cliniques (p. ex. présence ou absence d’intérêts)3, des prédicteurs moléculaires (p. ex. signatures métaboliques)4, des prédicteurs en neuro-imagerie (p. ex. volume de l’hippocampe)5 et les tracés électro-encéphalographiques6.
Les recherches de CAN-BIND – qui se limitaient initialement à la découverte de biomarqueurs – englobent maintenant la mise à l’épreuve et la validation des biomarqueurs candidats dans le cadre d’essais cliniques innovants dont le plan cible des populations plus vastes et est davantage représentatif des conditions cliniques réelles. Par exemple, les « essais plateformes » reposent sur un protocole maître qui peut intégrer des études d’intervention parallèles ou satellites grâce à un groupe témoin commun et à une population définie par des biomarqueurs7,8. Fait important, ces essais plateformes peuvent évoluer indéfiniment en raison du groupe témoin qu’ils ont en commun et de l’intégration de nouveaux groupes d’intervention au fil du temps7. De plus, si les résultats obtenus au sein d’un groupe de l’étude se révèlent supérieurs à ceux du groupe témoin, l’intervention utilisée dans ce groupe peut devenir la nouvelle norme à laquelle les interventions futures seront comparées8. Inversement, l’étude peut être arrêtée dans un groupe donné si l’intervention se révèle futile et se poursuivre dans les autres groupes, ce qui accélère les recherches et les découvertes.
Initialement élaborés pour l’oncologie, les essais plateformes – tous régis par un protocole maître – sont maintenant utilisés dans d’autres domaines thérapeutiques, notamment dans la recherche sur les troubles de l’humeur.
CAN-BIND a lancé un essai plateforme d’observation (régi par un protocole maître) pour la recherche sur les troubles de l’humeur intitulé ENABLE (Enabling Neuroscience research Approaches for Brain, feeLings and Emotions), lequel est financé à la fois par l’Institut ontarien du cerveau et la Fondation Brain Canada. Le Dr Benicio Frey, psychiatre et professeur titulaire, McMaster University, a décrit les objectifs de l’essai ENABLE dans les termes suivants : recruter une vaste population de patients âgés d’au moins 16 ans qui répondent aux critères diagnostiques des troubles dépressifs ou bipolaires dans le DSM-5-TR (population aux prises avec un trouble de l’humeur) et de patients en santé âgés d’au moins 16 ans qui n’ont aucun antécédent de trouble psychiatrique ou de trouble physique instable. Tout au long de l’essai, des données provenant du phénotypage clinique, de la neuro-imagerie, des tracés électro-encéphalographiques (ÉEG), de l’actigraphie et de tests moléculaires seront recueillies en prévision de la découverte de biomarqueurs et d’essais cliniques. À ce jour, l’objectif de recrutement de 40 à 50 patients par année a été dépassé, le jalon de 150 participants ayant été atteint en date d’octobre 2024.
Le Dr Rudolf Uher, psychiatre et professeur titulaire, Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse, est l’un des chercheurs principaux de l’essai OPTIMUM-D, lequel s’inscrit dans l’essai maître ENABLE. Fondé sur des biomarqueurs, cet essai sur le traitement personnalisé du TDM tente de répondre à une question importante : certains patients auraient-ils intérêt à recevoir d’emblée un traitement d’association reposant sur un antidépresseur de 1re intention et un agent d’appoint de 1re intention doté d’un mode d’action différent (antipsychotique atypique [APA]). L’essai utilisera un modèle d’attribution prédictive élaboré à la lumière des recherches antérieures de CAN-BIND selon lesquelles la probabilité de réponse à un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) en monothérapie est moindre chez les patients ayant peu d’intérêts (anhédonie) et des paramètres ÉEG particuliers.
OPTIMUM-D permettra de déterminer si le traitement de 1re intention par un antidépresseur et un APA est plus efficace qu’un antidépresseur en monothérapie chez certains patients.
Dans le cadre de l’essai OPTIMUM-D, des patients aux prises avec un TDM modéré ou sévère seront randomisés dans quatre groupes de traitement. Le modèle d’attribution selon un biomarqueur prédictif sera utilisé dans deux groupes et le modèle de randomisation traditionnel, dans les deux autres. Dans chacun de ces modèles, les patients recevront aléatoirement soit un ISRS en monothérapie, soit une association ISRS + APA. Le paramètre clinique principal sera l’évolution des symptômes dépressifs mesurée par le score MADRS à 8 semaines, mais plusieurs autres données seront recueillies, notamment : actigraphie, biomarqueurs moléculaires, biomarqueurs de la parole, et paramètres multimodaux (p. ex. tracé ÉEG + symptômes spécifiques de la parole).
Le Dr Uher conclut que le plan de l’essai OPTIMUM-D aidera à déterminer si l’attribution personnalisée permet d’améliorer les résultats obtenus avec le traitement d’association. Au nombre des caractéristiques uniques de l’étude figurent les suivantes : l’insu sera levé dans les groupes de traitement après 8 semaines et il sera alors possible d’optimiser le traitement pendant 4 autres semaines; les chercheurs suivront ensuite les patients pendant 18 mois afin de déterminer si la réponse s’est maintenue chez les répondeurs et s’il y a des prédicteurs de la rechute.
À ce jour, 68 participants ont été randomisés et 56 ont terminé l’étude. L’objectif est un effectif de 600 patients devant être atteint d’ici mars 2028.
Les faits saillants du symposium rapportés par nos correspondants se veulent une représentation juste du contenu scientifique présenté. Les opinions et les points de vue exprimés sur cette page ne reflètent pas forcément ceux de Lundbeck.