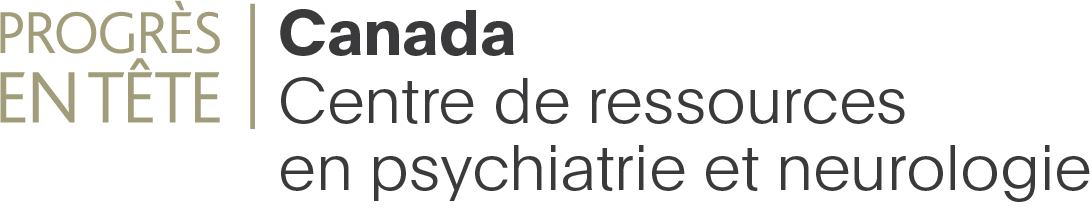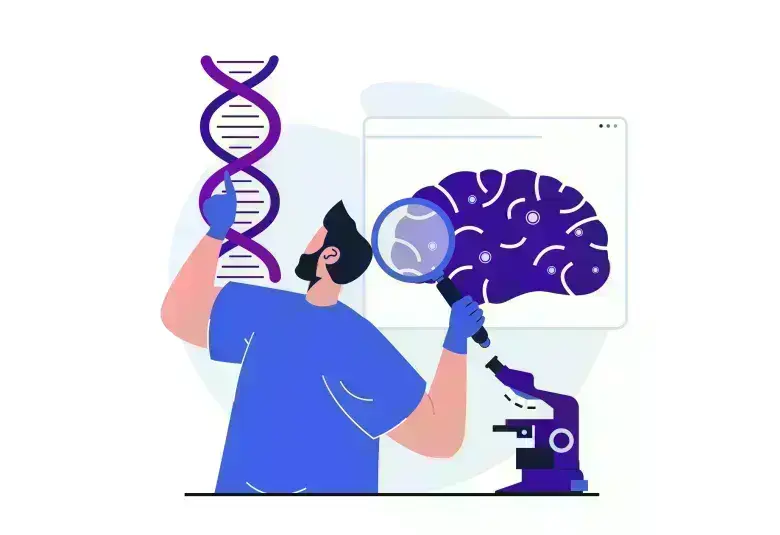Le premier congrès national sur les céphalées de la Canadian Headache Society (CHS) a démarré en force! Lors de la séance plénière inaugurale, les Drs Paul Cooper et Alex Melinyshyn et les Dres Élizabeth Leroux et Ioana Medrea ont présenté des faits éclairants sur la physiopathologie et l’épidémiologie de la migraine, l’approche narrative du diagnostic des céphalées, et les traitements ponctuel et préventif de la migraine. Ces présentations ont donné le ton pour la suite de cette première édition du congrès de la CHS.
Paul Cooper, MD, FRCPC, professeur de neurologie, Western University, a ouvert la première séance plénière en abordant une question largement débattue au cours des dernières décennies : le point d’origine de la douleur migraineuse dans le cerveau.
Bien que les douleurs migraineuses soient générées en périphérie1, c’est dans une région centrale, plus précisément dans l’hypothalamus, qu’est déclenchée la crise migraineuse2.
Les symptômes prodromiques tels que les bâillements et la fatigue3,4, ainsi que les modifications de l’appétit et les nausées5, sont liés au système dopaminergique, lequel met en jeu l’hypothalamus et d’autres régions cérébrales. De plus, on sait que l’hypothalamus joue un rôle dans le rythme circadien des crises migraineuses6 et leur association avec les fluctuations hormonales et le cycle menstruel7, ce qui semble indiquer que c’est dans cette région cérébrale que sont déclenchées les crises migraineuses.
Alexander Melinyshyn, MD, FRCPC, neurologue exerçant en privé à London, Ontario, Canada, a présenté l’approche narrative du diagnostic de migraine et souligné l’importance d’offrir au patient des outils de mesure faciles à comprendre pour évaluer la sévérité de ses crises migraineuses, notamment le système des « feux de signalisation »8. À l’aide de ce système, élaboré par Ana Marissa Lagman-Bartolome, MD, FRCPC, professeure agrégée de pédiatrie et de sciences neurologiques cliniques, Western University, et Christine Lay, MD, FRCPC, professeure titulaire de neurologie, University of Toronto, le patient peut classer ses crises migraineuses en trois paliers : feu vert (céphalée légère ou « Je peux encore avancer »), feu jaune (céphalée modérée ou « Je dois ralentir ») ou feu rouge (céphalée sévère ou « Je dois m’arrêter »).
Comparativement à une échelle de 0 à 10, cette approche aide le patient à mieux évaluer la sévérité de ses crises migraineuses.
Selon Élizabeth Leroux, MD, FRCPC, chargée d’enseignement, Département de neurologie, Université McGill, le traitement ponctuel des crises migraineuses repose sur plusieurs grands principes. Notamment, l’instauration rapide d’un traitement ponctuel est cruciale, bien qu’elle puisse poser des difficultés à mesure que le patient avance en âge9. En effet, avec l’âge, la fréquence des crises nocturnes augmente, ce qui peut compliquer la prise précoce d’un agent ponctuel. Un autre principe, recommandé dans les lignes directrices de la CHS sur le traitement ponctuel de la migraine10, est le recours à une association de médicaments ponctuels si la prise d’un seul agent ponctuel n’est pas efficace.
Parmi les autres principes qui sous-tendent une prise en charge optimale des crises migraineuses figurent l’éducation du patient et les interventions comportementales.
Ioana Medrea, MD, FRCPC, clinicienne-chercheuse, Women’s College Hospital Centre for Headache, a conclu cette première séance plénière en présentant les nouvelles lignes directrices de la CHS sur la prévention de la migraine, dont la version précédente remontait à 201211. Parmi les ajouts importants à la version antérieure figurent des recommandations concernant la migraine chronique et la nouvelle classe thérapeutique des anti-CGRP; en outre, les auteurs ont actualisé les recommandations au sujet de certains agents préventifs afin de tenir compte des résultats d’études récentes. Dans les lignes directrices actualisées, ils proposent aussi de nouvelles stratégies pour le traitement de populations particulières, notamment les patients qui ont besoin d’un traitement de 1re intention ou souhaitent restreindre les effets indésirables, les patients présentant un IMC élevé, une hypertension artérielle ou des symptômes d’anxiété/de dépression, ou encore les patients aux prises avec une migraine épisodique de fréquence élevée ou une migraine chronique.
Aux yeux des professionnels de la santé, ces nouvelles lignes directrices sur la prévention de la migraine constitueront assurément un outil important pour le traitement de la migraine à la lumière des plus récentes données probantes de la plus haute qualité.
Des dizaines de fournisseurs de soins de santé du Canada s’intéressant au traitement de la migraine ont assisté à cette séance plénière, laquelle a jeté les bases de la première édition du congrès de la CHS et conduira certainement à l’évolution de la prise en charge de la migraine au Canada.
Les faits saillants du symposium rapportés par nos correspondants se veulent une représentation juste du contenu scientifique présenté. Les opinions et les points de vue exprimés sur cette page ne reflètent pas forcément ceux de Lundbeck.