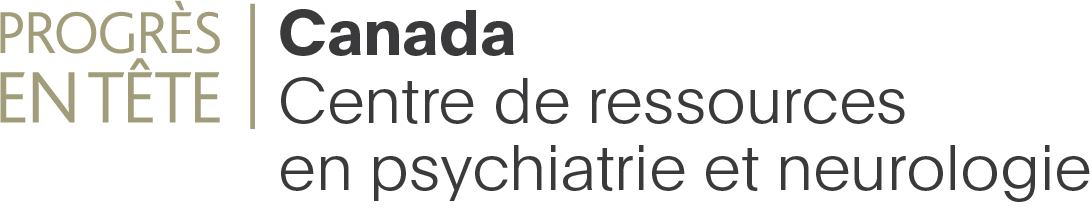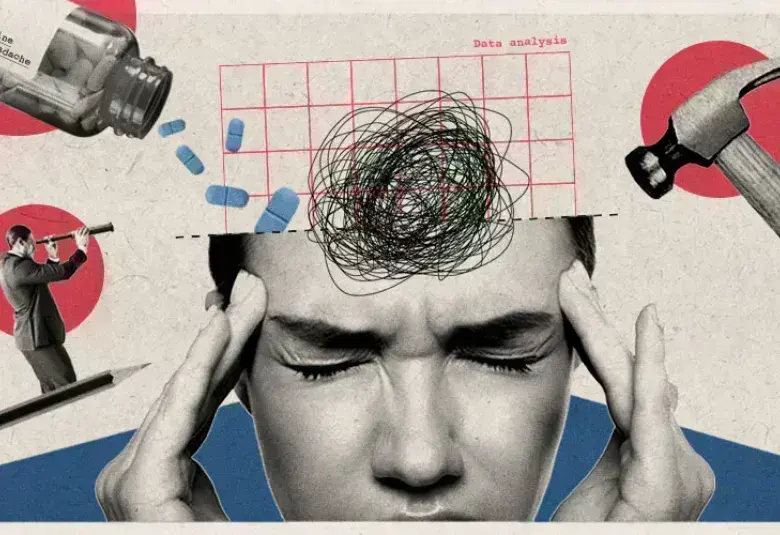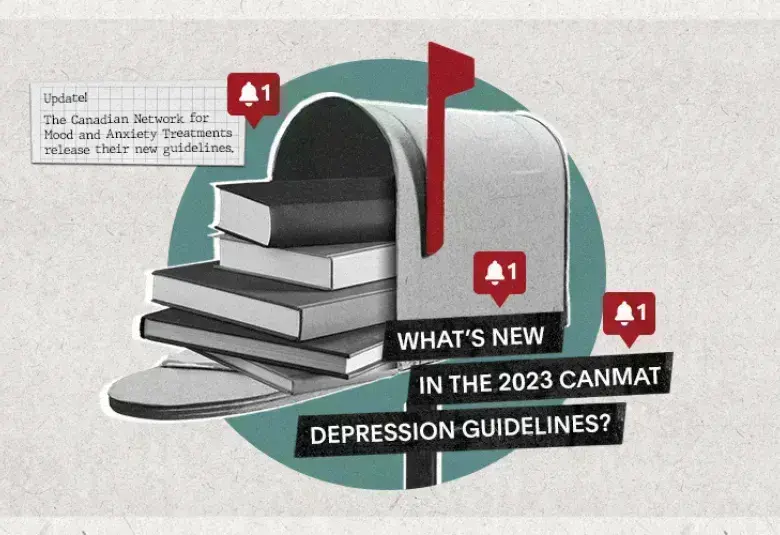Assez fréquent, le trouble Déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) persiste souvent à l’âge adulte, mais il arrive aussi qu’il soit diagnostiqué seulement à l’âge adulte. Vu les conséquences négatives non néglideables qu’un TDAH non maîtrisé peut avoir tout au long de la vie, il est impératif de le détecter tôt afin de pouvoir offrir un traitement personnalisé aux patients qui en souffrent. Dans le cadre d’un webinaire éducatif intitulé Improving the Lives of Patients with ADHD offert par le Neuroscience Education Institute (NEI), le Dr Timothy Wilens, professeur titulaire de psychiatrie, Harvard Medical School, a donné un aperçu des nouveautés dans le traitement du TDAH à toutes les étapes de la vie.
À quelle fréquence survient le TDAH? Dans quelle mesure impose-t-il un lourd fardeau?
Les données montrent systématiquement que le TDAH est un trouble fréquent à la fois chez les enfants et les adolescents (8,7 % chez les 8 à 15 ans) et les adultes (4,4 % chez les 18 à 44 ans) et qu’il est souvent chronique et persistant1-3. Contrairement à la croyance populaire, la prévalence du TDAH est relativement constante partout dans le monde4.
Le TDAH n’est pas plus répandu aux États-Unis que dans d’autres pays
Il est d’une importance capitale de détecter et de traiter un TDAH le plus tôt possible, car un TDAH non maîtrisé peut avoir d’importantes conséquences sur le développement. Notamment, les problèmes de comportement qui apparaissent en garderie ou à la maternelle peuvent contribuer aux difficultés à l’école et dans les relations avec les pairs chez les enfants d’âge scolaire de même qu’à une piètre estime de soi3,5. Ces problèmes – qui peuvent persister chez les adolescents et les jeunes universitaires – peuvent mener à des échecs scolaires, au tabagisme/vapotage et à des troubles liés à une substance, à des démêlés judiciaires, et à un risque accru de blessures3,5. Faute d’être traité, le TDAH peut contribuer à des échecs professionnels, à des difficultés relationnelles ainsi qu’à des accidents/blessures causés par des comportements à risque5. Plus récemment, le TDAH chez l’adulte a été associé à un risque accru de démence à une étape ultérieure de la vie, tandis que le risque accru de démence n’était pas si clair chez les adultes atteints d’un TDAH qui avaient reçu des psychostimulants6.
Le manque d’estime de soi apparaît tôt, peut être difficile à éliminer et persiste souvent à l’âge adulte
Dépistage et diagnostic d’un TDAH
Le TDAH est un diagnostic clinique. De l’avis du Dr Wilens, la classification du TDAH proposée dans le DSM-5 – trois sous-types de TDAH: inattention, hyperactivité-impulsivité, et présentation combinée3,7 – n’est plus si pertinente. On s’attache plutôt à différencier le TDAH d’un trouble du spectre de l’autisme. Les symptômes cognitifs comme l’inattention sont au cœur du TDAH et sont présents dans la vaste majorité des cas3. Comme de nombreux adultes développent des mécanismes de compensation au fil du temps, il peut être utile d’avoir recours à des échelles validées comme l’échelle ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale)3,8.
Les échelles d’autoévaluation du TDAH destinées aux adultes sont fiables alors que les observations des parents ou des enseignants sont utiles pour le dépistage du TDAH chez les enfants8,9.
La comorbidité étant la règle plutôt que l’exception dans le TDAH, il est important d’être à l’affût de troubles médicaux, psychosociaux, cognitifs et psychiatriques concomitants3. Dans le cadre de l’étude intitulée National Comorbidity Survey Replication (n = 3199), le trouble dépressif majeur, le trouble bipolaire, les troubles anxieux, le trouble du stress post-traumatique et le trouble lié à une substance étaient tous significativement plus fréquents chez les répondants atteints d’un TDAH que chez ceux qui n’en étaient pas atteints2. Le Dr Wilens a fait remarquer que, comparativement aux populations des études épidémiologiques, les taux de prévalence sont encore plus élevés dans les cohortes cliniques.
Lorsque les antécédents médicaux ne révèlent rien de particulier, les examens de laboratoire et les examens neurologiques ne sont pas indiqués.
Des études d’imagerie ont montré que des parties différentes du cerveau sont activées en réponse à une tâche cognitive chez les personnes aux prises avec un TDAH, comparativement à des témoins en santé10. Inversement, le traitement d’un TDAH à l’aide de psychostimulants ramène l’activité cognitive du cerveau à la normale11.
Qu’y a-t-il de nouveau dans la pharmacothérapie du TDAH?
Plusieurs classes de médicaments d’ordonnance sont homologuées pour le traitement du TDAH, notamment des stimulants et des non-stimulants (p. ex. des agents noradrénergiques, des agonistes des récepteurs alpha-adrénergiques et des antidépresseurs)3 et plusieurs nouveaux agents sont à divers stades de leur développement clinique. Il existe différentes préparations de stimulants sur le marché, notamment des agents oraux et des timbres transdermiques. Bien que cela puisse compliquer les choix de traitement pour les médecins qui ne sont pas des experts du TDAH, le Dr Wilens leur recommande de se familiariser avec un ou deux psychostimulants à courte durée d’action et un ou deux psychostimulants à longue durée d’action de même qu’avec leurs durées d’action précises et leurs schémas d’administration. En général, les psychostimulants et les agents à longue durée d’action qui existent sous forme de promédicaments sont associés à un potentiel moindre de mauvais usage ou de détournement3.
La durée d’action varie grandement parmi les préparations de psychostimulants
Le TDAH est un trouble chronique qui nécessite un traitement de longue durée
Compte tenu de la nature chronique du TDAH, il n’est pas étonnant que le risque de récidive soit élevé après l’arrêt du traitement12 . Il est rassurant de constater que, selon de plus en plus de données, le traitement prolongé par un psychostimulant n’est pas associé à une cardiotoxicité cliniquement significative13 ni à des effets neurotoxiques sur la structure et le fonctionnement du cerveau14; en effet, la mortalité globale semble plus faible dans les cas où un traitement médicamenteux pour le TDAH a été instauré15. En outre, il a été démontré qu’un traitement de longue durée par un psychostimulant donne lieu à de multiples améliorations fonctionnelles significatives, notamment sur le plan de la performance scolaire, ainsi qu’à des réductions du risque d’accident/de blessure, de trouble lié à une substance, de suicidalité/d’automutilation et de troubles de l’humeur16.
Chez les enfants et les adolescents, les effets des psychostimulants sur les courbes de croissance sont généralement faibles et transitoires17.
Bien qu’il existe un arsenal croissant de médicaments efficaces et sûrs pour le traitement du TDAH chez les enfants et les adultes, le Dr Wilens préconise le recours à l’utilisation complémentaire de stratégies non médicamenteuses, notamment la thérapie comportementale, la remédiation des aptitudes sociales, la psychothérapie et le counselling3,18-20. Ces approches ont généralement une efficacité maximale lorsqu’elles sont associées à une pharmacothérapie puisqu’elles peuvent améliorer les stratégies de compensation avec le temps.
Les faits saillants du symposium rapportés par nos correspondants se veulent une représentation juste du contenu scientifique présenté. Les opinions et les points de vue exprimés sur cette page ne reflètent pas forcément ceux de Lundbeck.